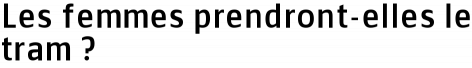En ville
Dans une récente publication |1|, Claudine Lienard fait le point sur la mobilité au féminin, en s’appuyant sur une série d’études scientifiques et d’actions menées dans le cadre de l’éducation permanente en Wallonie, en particulier avec des femmes en situation de précarité. L’ouvrage reste cependant fort vague sur la manière concrète d’adapter un projet de mobilité aux réalités de déplacement des femmes. Cette analyse saisit l’opportunité qui nous est donnée avec le projet de tram liégeois de réfléchir à la manière de traduire et d’intégrer les spécificités féminines dans la conception d’un transport en commun et de modifier en conséquence le réseau existant. L’intérêt de cet angle d’approche n’est pas seulement le genre en tant que tel : il permet en filigrane de mettre en lumière certains aspects qui sont valables pour toutes les personnes précarisées, à propos desquelles il n’y aurait que peu d’étude sans l’utilisation du focus genre, tant l’intérêt des concepteurs urbains est faible pour ces populations insignifiantes tant dans le rapport de force socio-économique — une infrastructure publique doit être rentable — qu’environnemental — permettre à un piéton de monter dans un bus ne contribue pas à réduire les émissions de CO2.
Dans un premier temps, une présentation des arguments de genre en terme de mobilité nous permettra de poser un cadre de réflexion, que nous transposerons ensuite en principes à respecter pour la conception d’un transport en commun adapté aux types de mobilité féminines. Enfin, nous analyserons l’actuel projet de tram liégeois au regard de ces principes.
La mobilité des femmes
Les études et les discours politiques concernant le futur tram liégeois sont basés essentiellement sur des conceptions économiques, fonctionnelles et quantifiables des déplacements : rentabilité, flux de voyageurs, vitesse commerciale. Un « bon tram » est un tram qui permettra de transporter un maximum de voyageurs en un minimum de temps, et la définition du tracé se prend en fonction de ce gage de réussite. Or, du point de vue des usagers, la définition d’un tram efficace peut-être sensiblement différente en fonction des usages que l’on a de la mobilité, ceux-ci étant étroitement liés aux causes des déplacements, à leur distance, à leur organisation entre eux, au rapport à l’espace et au temps. Ces facteurs sont sensiblement différents selon le sexe des personnes.
Concernant les distances parcourues, tout d’abord, les femmes privilégient la proximité. Même lorsqu’elles disposent d’une voiture, elles préfèrent un emploi proche du domicile à un emploi éloigné mais correspondant mieux à leurs qualifications. Ce phénomène s’observe d’autant plus que les femmes sont peu qualifiées, qui négligent des compétences professionnelles acquises précédemment au profit de la proximité. Par contre, elles multiplient les déplacements dans cette zone de proximité, passant sans cesse d’une activité à l’autre. Ce phénomène est accentué par des emplois à temps partiels et à horaires flexibles, qui obligent parfois à plusieurs déplacements professionnels vers des lieux différents sur une même journée. Les secteurs de travail « au domicile des clients », tels que les aides ménagères, aides familiales, aides soignantes ou infirmières à domicile contribue aussi à renforcer ce schéma : un habitat éloigné de la zone de travail rendrait impossible le fait de repasser à la maison entre deux plages horaires.
La diversité des tâches qui incombent encore largement aux femmes, surtout lorsqu’elles ont des enfants, n’est pas non plus sans impact sur la distance des trajets parcourus : il s’agit d’être à l’heure aux bons endroits et de savoir tout faire en un laps de temps donné, ce qui exclut de facto les grandes distances.
En conséquence, la mobilité des femmes se joue dans un périmètre plus restreint, mais avec des activités plus nombreuses, de sorte que l’organisation des déplacements est différentes de celles des hommes : là où les hommes vont en grande partie effectuer des trajets dits « pendulaires », c’est-à-dire des « aller-retour » simples tels que domicile – travail – domicile, ou encore domicile - loisir - domicile, les femmes opèrent des circuits plus complexes, tels que domicile - halte-garderie - école - travail – école – halte-garderie - courses - visite familiale - domicile.
Le rapport à l’espace public est également à prendre en compte pour la compréhension des choix de mobilité différents entre les hommes et les femmes. Le confinement historique et culturel des femmes dans la sphère privée, familiale, influence leur perception des déplacements dans l’espace public. Les motifs de déplacement sont encore souvent liés aux activités de la sphère privée (courses, famille, enfants). Pour un grand nombre de femmes, en particulier lorsqu’elle sont sans emploi, l’espace public n’est parfois vécu que comme un lieu de passage entre un point privé et un autre point privé, là où les hommes vont préférer investir la place publique comme un lieu d’activité et de rencontre à part entière. L’enjeu du transport en commun adapté aux déplacements de ces femmes est donc aussi celui de leur fournir des espaces de rencontres, que ce soit aux arrêts ou dans les transports à proprement parler. Ceci est d’autant plus vrai qu’intervient un autre facteur, celui du sentiment d’insécurité dans l’espace public, que les femmes contre-carrent en partie par la création d’habitudes de déplacements, c’est-à-dire par qu’elles empruntent le plus souvent possible le même trajet, aux mêmes heures, ce qui est propice à la rencontre.
Le sentiment d’insécurité des femmes dans l’espace publique reste une réalité. L’on peut dès lors se poser la question de l’auto-censure des femmes par rapport à leurs déplacements. L’étude du nombre total de déplacements, ainsi que leur répartition en fonction du moment de la journée et de la semaine permettrait d’étayer cette hypothèse et de vérifier si la mobilité des femmes est avant tout une mobilité « contrainte » (travail, tâches familiales).
Nous disposons par contre des chiffres qui indiquent que, bien que de plus en plus nombreuses à disposer d’un permis de conduire et d’un véhicule personnel, les femmes effectuent une plus grande part de leurs trajets automobiles en tant que passagère que les hommes, qui préfèrent prendre le volant. On peut bien entendu y voir un signe de domination : celui qui conduit contrôle. Mais on peut peut-être aussi y voir un deuxième type de sentiment d’insécurité, par rapport au risque d’accident, et de la responsabilité de celui-ci. L’hypothèse est que la combinaison du sentiment d’insécurité dans l’espace public et des effets néfastes du stéréotype intériorisé de la « femme au volant » pousserait les femmes à rester chez elles, à opter pour la place du passager ou les transports collectifs, à se déplacer le moins loin, donc le moins de temps, tout cela afin de réduire un certain nombre de risques.
Les spécificités en terme de nombre, de longueur, de fonctions des déplacements des femmes sont ainsi perçus comme résultant de plusieurs facteurs qui se renforcent mutuellement : perpétuation des rôles sociaux, type de travail disponible, stéréotypes, sentiment d’insécurité.
Changer la manière de concevoir le transport en commun
La manière de concevoir un réseau de transport en commun ne va certainement pas pouvoir résoudre l’ensemble de ces problèmes, ni même agir sur chacun d’entre eux. Néanmoins, une réflexion globale et écologiste sur la mobilité, qui réduirait la pression automobile (donc le risque d’accident, le risque d’imprévus dans les horaires, et le temps de trajet moyen) et offrirait un panel d’alternatives de mobilités douces, en ce compris pour les piétons, irait de facto dans le sens d’une meilleure prise en comte des besoins actuels des femmes en déplacement, mais aussi dans le sens de leur émancipation.
Le premier principe à respecter pour concevoir un transport collectif urbain soucieux de respecter les spécificités féminines est d’abord d’offrir une mutiplicité de possibilités de parcours. On préférera donc un réseau maillé, avec un nombre d’arrêts élevé desservant les quartiers d’habitation, dont les différents types de transports sont inter-connectés en plusieurs endroits (train/tram/bus/vélo/autres), et ce afin de permettre facilement des types de mobilité qui comportent plusieurs points d’arrêt sur un même parcours non-rectiligne.
Ensuite, la fréquence des passages doit être élevée, de manière à minimiser les risques de retard, rédhibitoires lorsque les horaires sont calculés à la minute près. Il ne s’agit pas tant d’une question de vitesse que de stabilité, de fiabilité, qui permet de prévoir une organisation précise des tâches à effectuer.
L’aménagement des arrêts et le choix du matériel roulant doivent contribuer à réduire le sentiment d’insécurité, par leur convivialité, leur éclairage, leur accès physique. Cela permettra en outre de favoriser la rencontre entre personnes.
Le tram liégeois sous les lunettes du genre
Le projet de tram du gouvernement wallon pour a ville de Liège se présente sous la forme d’une ligne unique, desservant la rive gauche de la Meuse entre Jemeppe et Basse-Campagne. Trois lignes de bus à haut niveau de service (BHNS) se rabattent sur elle en plusieurs endroits, de manière à former un modèle de transport dit « en arrêtes de poisson », ce qui signifie que les connexions entre les lignes secondaires ne peuvent se réaliser que via la ligne principale, augmentant ainsi le nombre de ruptures de charge. Il ne s’agit donc pas d’un réseau maillé mais d’une ligne principale qui correspond mieux à des déplacements pendulaires, encore majoritairement effectués par les hommes.
En outre aucune connexion n’est prévue avec le réseau de chemins de fer. L’inter-modalité n’a pas été pensée au départ de la réflexion, ce qui compromet sa pertinence par la suite. A ce stade, la discussion sur les arrêts et leur impact urbanistique n’a pas encore eu lieu, pas plus que sur le choix du matériel. Nous pouvons craindre que la prise en compte des femmes ne se restreigne à ces aspects, alors que la structure même du réseau est bien plus fondamentale puisqu’elle répond aux aspects organisationnels indispensables pour les contraintes familiales et professionnelles des femmes, et qui — soit dit en passant — tend à se répandre aux hommes, vue l’évolution de la flexibilité de l’emploi.
La parole des femmes
Bien qu’utilisatrices principales des transports en commun, les femmes n’ont pas été associées au processus de concertation organisé par le Ministre de la Mobilité. Ceci eût été d’autant plus nécessaire que, parmi les personnes en charge du dossier ou responsables de son implémentation dans les communes, les femmes sont quasiment absentes, que ce soit au sein des administrations ou parmi les responsables politiques en charge de la mobilité aux différents niveaux de pouvoir, et dans leur cabinet. La dimension du genre a pourtant bien toute son importance, comme le montre cette analyse. Si elle n’est pas prise en compte, l’effet risque bien d’avoir des effets contraires à la mission d’un service public : les inégalités existantes entre usagers, hommes et femmes, mais aussi personnes aisées et précarisées, seront renforcées.
|1| LIENARD, C., « Ça roule, ma poule ? », Théories et actions collectives de femmes pour la mobilité en Wallonie, Cahiers de l’Université des femmes n°5, septembre 2010. Les éléments théoriques de cette analyse en sont issus.
À propos de l'auteure
Mathilde Collin est permanente syndicale et membre du Conseil d’administration d’urbAgora.
Cette publication a reçu le soutien
du ministère de la culture,
secteur de l'Education permanente