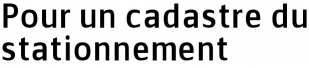En ville
Encombrante s’il en est, la question de savoir où il convient de ranger les automobiles lorsqu’on ne les utilise pas — ce qui est le cas la plus grande partie du temps — et les réponses qu’on y donne sont fondamentales dans toute politique d’urbanisme. Il semble pourtant que les uns et les autres — ceux qui plaident pour l’accroissement systématique de l’offre de stationnement comme ceux cherchent à la stabiliser ou à la faire décroître — soient bien mal informés des détails de la situation. Nous plaidons dès lors ici pour la mise en place d’un outil d’information permettant d’éclairer la politique de stationnement — et donc la politique urbanistique.
Alors que de nouvelles infrastructures de stationnement ont ouvert récemment leurs portes (gare des Guillemins : 850 places, Médiacité : 2350 places) ou doivent le faire d’ici quelques années (Bavière : 700 places, Tour des finances, Projet d’immeuble de bureau rue du Plan incliné,...) et vont mécaniquement accroître l’offre de parking aux abords immédiats de l’hypercentre et par conséquent la saturation d’une série de voiries, les autorités communales envisagent d’investir une somme importante (15 millions d’euros ? 30 millions d’euros ? Plus ? Personne ne semble encore le savoir) dans la construction de deux nouvelles infrastructures de grandes dimensions sous la place Cockerill (jusqu’à 600 voire 800 places, aux dernières nouvelles) et sous le boulevard d’Avroy (on cite le chiffre de 250 places).
Selon M. Demeyer et Mme Yerna, principaux responsables de ce projet et respectivement bourgmestre et échevin des affaires économiques de la Ville de Liège, ces nouveaux parkings répondent à deux objectifs.
D’une part, il s’agit, pour maintenir, à les en croire, l’attractivité d’un commerce urbain qui peine à faire face à la concurrence des centres commerciaux en périphérie, de faire baisser le prix du parking en ville, en proposant un prix (légèrement) inférieur à celui qui est pratiqué par le secteur privé, qui gère actuellement la totalité de l’offre publique en ouvrage au centre-ville (Cathédrale, St Lambert, St Denis, St Paul, Neujean, St Georges,...).
D’autre part, il s’agit de réduire l’espace occupé par le stationnement en voirie pour regagner de la place au profit d’autres fonctions, améliorer la qualité de l’espace public en le libérant de l’emprise de la voiture et finalement promouvoir une autre mobilité, multimodale, plus douce, plus tournée vers le transport public. À plusieurs reprises |1|, les responsables communaux ont d’ailleurs affirmé que les nouveaux parkings souterrains n’augmenteraient pas l’offre globale mais se contenteraient de transférer des places actuellement situées en voirie vers ces nouveaux ouvrages.
Les contradictions entre ces deux objectifs sautent malheureusement aux yeux.
Comment la Ville peut-elle raisonnablement espérer jouer un rôle de price-maker — établir le prix de marché du stationnement au centre-ville —, rôle qu’elle estime manifestement être incapable de jouer aujourd’hui, si elle ne modifie pas le nombre d’emplacements de stationnement ? Cela semble difficile à comprendre si on rappelle que la Ville est d’ores et déjà en mesure de régler la politique tarifaire des emplacements en voirie.
Et s’il s’agit d’augmenter sans le dire l’offre de stationnement au centre-ville, faut-il vraiment prendre pour argent comptant les déclarations annonçant une « réappropriation » (selon la terminologie consacrée) de l’espace public par des piétons et des cyclistes usuellement fort mal lotis à Liège ?
Plus grave encore, cette augmentation de l’offre qui se profile serait, si elle se confirme, totalement injustifiable au regard des objectifs que la Ville s’est elle-même fixée dans son Plan de mobilité mais aussi de l’arrivée annoncée en ville du tramway, dont chacun devrait savoir qu’il obligera à de douloureux arbitrages quant à l’occupation de l’espace public — en ce compris sur certaines des grandes voies pénétrantes, au détriment de l’espace actuellement occupé par les voitures — et nécessitera, pour être un succès en termes de fréquentation, une sérieuse remise en question de l’omniprésence automobile qui prévaut actuellement jusque sur la place Saint-Lambert.
Enfin et de surcroît, il y a fort à parier que les effets réels de la construction de ces nouveaux parkings s’avèrent des plus réduits pour le commerce dans un contexte de saturation commerciale qui s’aggrave d’ailleurs d’année en année avec l’inflation incontrôlée du commerce périphérique.
Ces contradictions dans le chef de la Ville — et les atermoiements qu’elles suscitent, appellent diverses observations.
a) L’offre de stationnement crée la demande — c’est l’effet d’appel. La réponse à la question « Qui veut du stationnement facile partout » ? est connue d’avance. Le Plan communal de mobilité indique que l’offre liégeoise est élevée mais très mal régulée. Il faut inverser la tendance et ne pas se demander « Quelle offre est nécessaire ? » mais « Quelle offre est supportable ? ». Le fait de trouver du stationnement aisé proche de sa destination est le facteur le plus puissant de choix en faveur de la voiture. Même demain avec un tram, si on ne change pas la « gestion » du stationnement, le transfert modal vers les TC restera faible. Bref, une réflexion prospective sur l’avenir de la ville à moyen et long terme fait manifestement défaut dans ce débat. Les conséquences de la forte perméabilité du centre aux voitures (engorgement des pénétrantes, pollution de l’air, éviction de fait des modes doux de certaines zones, allongement des temps de parcours des bus, mauvaise image de la ville,...) sont pourtant probablement plus dommageables à l’activité du centre-ville (commerciale ou autre) que le coût éventuellement élevé du parking. Le risque est pourtant bien réel d’aggraver la situation par une action qui se limiterait à rendre le stationnement plus accessible. L’arrivée du tram, qui va notamment réduire la place accordée à la voiture dans le centre-ville et sur les voiries pénétrantes, devrait à l’inverse permettre de suivre l’exemple des autres villes européennes. En offrant une alternative confortable, rapide et bon marché à la voiture individuelle, on peut en effet espérer convaincre une part significative des automobilistes d’opter pour le transport en commun. Bref, à moyen terme, c’est une substantielle réduction de l’offre qui doit être envisagée. Il s’agit même d’une condition de réussite du tram.
b) L’expropriation de tout ou partie des parkings existant, en vue de leur gestion publique, n’a semble-t-il pas été envisagée. Si l’objectif des autorités communales est de faire concurrence au secteur privé et de permettre l’application d’une politique tarifaire finement adaptée à la politique de mobilité, cette hypothèse serait pourtant intéressante et justifiée (et probablement moins coûteuse). Soit dit en passant, une série de permis d’exploiter (permis d’environnement) de parkings en ouvrage été renouvelée assez récemment, sans attention, pour ce que l’on en sait, à l’encadrement de l’offre (prix,…).
c) Le lien doit de toute évidence être fait avec la politique d’aménagement du territoire. Le maintien d’une activité commerciale forte dans l’hypercentre est indéniablement souhaitable. Mais c’est une illusion d’imaginer que le commerce en centre ville puisse prospérer en appliquant les mêmes recettes que le commerce périphérique : jouer à outrance la carte de la voiture bénéficiera toujours à la périphérie. Il faut donc, évidemment, des outils de régulation forte, portant sur la périphérie et les zones centrales, mais il faut aussi développer des concepts commerciaux adaptés au centre. Une autre illusion est d’imaginer que le maintien du commerce au centre est compatible avec la poursuite du développement, dans l’arrondissement, d’une offre commerciale qui est d’ores et déjà excédentaire – une situation que l’ouverture de la Médiacité va encore aggraver. ? cet égard, on rappellera que la construction possible d’un centre commercial à Soumagne ou l’ambition du Standard d’en développer un autre autour de son nouveau stade vont nettement dans le mauvais sens.
d) Enfin et surtout, la connaissance de l’utilisation effective des infrastructures existantes est lacunaire. C’est pourquoi la réalisation, préalablement à tout investissement, d’un cadastre du stationnement au centre-ville semble la première étape. Quel est le taux de remplissage des différents parkings à quels moments de la journée et de la semaine ? Dans quelle mesure une variation du prix entraîne-t-elle une variation de la demande ? Nous ne connaissons pas, à ce jour, les réponses à ces questions.
La mise en place d’un cadastre du stationnement semble dès lors la première mesure à mettre en place, sur laquelle il sera possible de fonder une politique adéquate.
Cette analyse constitue l’une des bases sur lesquelles a été construite l’action « Parking Day » menée le 17 septembre 2010, et la conférence de presse qui a été présentée à cette occasion.
|1| Le présent article est notamment basé sur les débats du Conseil communal.
À propos de l'auteur
Cette publication a reçu le soutien
du ministère de la culture,
secteur de l'Education permanente