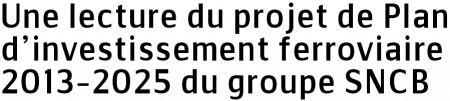Analyse
Avant d’entamer la lecture du projet de plan d’investissement de la SNCB, il est primordial de rappeler l’importance des montants en jeu et celle, croissante, des enjeux de mobilité. En période de disette budgétaire, il est capital pour le pays et la crédibilité de ses institutions que les priorités retenues par les pouvoirs publics soient pertinentes, qu’elles s’intègrent dans des perspectives cohérentes et porteuses d’avenir et que la concrétisation des projets soit à la hauteur des attentes. En d’autres termes, une vision stratégique claire et, autant que faire se peut partagée, est cruciale lorsque des choix cornéliens se profilent. Il convient en particulier d’éviter les coupes linéaires qui frappent indistinctement tous les projets, sans égard pour leur importance, leur qualité ou les conditions de leur succès.
1. Le cadre général
Les investissements ferroviaires doivent être mis au service d’une politique intégrée de mobilité et d’aménagement du territoire.
En effet, les problèmes de mobilité ne peuvent s’appréhender à travers le prisme unique de la congestion croissante dans et autour des villes tant des infrastructures routières que, dans certains cas, des réseaux de transport en commun. L’augmentation continue des circulations, et notamment des circulations automobiles, entraine avec elle un large cortège de problèmes environnementaux, économiques et sociaux. Pour ne citer que le plus marquant d’entre eux, faut-il rappeler que près d’un millier de personnes perdent la vie chaque année sur nos routes |1| ? À l’heure où l’on se préoccupe beaucoup, non sans raison, de sécurité ferroviaire suite à la catastrophe de Buizingen, c’est l’équivalent de près cinquante catastrophes analogues qui ont lieu chaque année sur les routes. Autrement dit, chaque point de pourcentage de part modale gagné sur la route sauve chaque année de nombreuses vies humaines.
Les changements ne se feront pas d’eux-mêmes. En l’absence d’orientation politique, l’augmentation des circulations tend à s’auto-entretenir. Un cercle vicieux est en effet largement à l’œuvre et n’est que très partiellement contrecarré par l’augmentation tendancielle du coût des carburants. L’omniprésence de la voiture et l’engorgement des villes dégradent l’attractivité des centres urbains tant pour les habitants que pour de nombreuses activités économiques et commerciales. Les uns comme les autres, lorsqu’ils en ont les moyens cherchent à échapper à la congestion et aux nuisances en colonisant les zones autrefois rurales, encouragées en cela par la concurrence entre les communes pour attirer les résidents taxables et les entreprises pourvoyeuses d’emplois. Cette évolution renforce l’éclatement des activités humaines, résidentielles comme économiques, sur le territoire. Ce phénomène de périurbanisation tue petit à petit tant la ville que la campagne. Ce faisant, la demande de déplacement est multipliée d’autant tout en rendant à la fois moins attractives et plus coûteuses toutes les alternatives à la voiture individuelle basées soit sur des modes doux reposant sur des trajets courts et de qualité soit sur des transports en commun nécessitant une densité minimale d’occupation du territoire pour fournir des solutions compétitives à un coût raisonnable. Dans ces conditions, il est illusoire de jamais répondre aux problèmes de congestion par une approche centrée uniquement sur la gestion des flux actuels de circulation. L’augmentation de la capacité des infrastructures aux principaux points d’engorgement des réseaux de transport ne sera jamais qu’un emplâtre sur une jambe de bois, à moins d’investir des sommes sans cesse croissante pour accroître en permanence et entretenir des réseaux au bord de la saturation.
Il faut donc réfléchir autrement. Il s’agit de développer une vision alternative à celle qui a dominé la planification des réseaux de transport depuis l’après-guerre. Ce constat amène en effet à coupler les politiques d’aménagement du territoire et de revalorisation des centres urbains, grands et petits, d’une part et le maillage réseaux de transports en commun, d’autre part. L’objectif est d’engendrer un cercle vertueux. Le recentrage progressif des activités humaines autour des pôles bien desservis par les transports en commun permet de concevoir une offre de déplacements performante tout en contrôlant les coûts d’exploitation. Dans le même temps, l’existence d’alternatives performantes au tout à la voiture couplée à des politiques volontaristes favorisant la qualité de vie en ville contribue à ramener habitants et activités économiques dans des environnements davantage urbains. Ce faisant, il est possible de diminuer la demande globale de déplacements tout en générant des flux localisés suffisamment importants pour rendre des services collectifs à la fois compétitifs et finançables. De plus, afin d’éviter au maximum que les réseaux de transports en commun ne connaissent les mêmes problèmes d’engorgement que le réseau routier en ses points névralgiques, il convient de privilégier une offre densément maillée plutôt que centralisée en un petit nombre de points. Ceux-ci sont en effet alors autant de points de fragilité mettant en péril la robustesse et les performances de l’ensemble du réseau. Un réseau bien maillé permet de surcroît de limiter la pression foncière et les effets de dualisation et de précarisation qu’elle entraîne. Il permet en effet de soutenir un développement territorial qui évite les travers engendrés par un trop grand éparpillement des activités humaines mais également les problèmes générés par une trop grande polarisation autour de quelques centres principaux.
Dans un tel schéma, le rail occupe assez naturellement un rôle structurant. D’une part, du fait de ses performances et de ses capacités, il occupe nécessairement un rôle structurant dans une offre hiérarchisée de transports en commun. D’autre part, les abords des gares et points d’arrêts sont des points névralgiques du territoire requérant une attention particulière.
2. Analyse du plan d’investissement
Ce cadre étant posé, nous devons constater combien le plan d’investissement, tant dans sa méthodologie, que dans son contenu, n’est pas à la hauteur des enjeux.
2.1. Remarques méthodologiques
La lecture du plan trahit tout d’abord la reproduction des travers typiques de la culture du groupe SNCB. Le document laisse transparaître une volonté du groupe SNCB de garder au maximum la mainmise sur la définition des options de long terme du développement du réseau et de son exploitation. A travers le choix des informations fournies et leur présentation, il est difficile de ne pas penser que le groupe ou ses entités ont surtout veillé à conserver des marges de manœuvres aussi larges que possibles quant à la définition de la stratégie ferroviaire en Belgique, quant à son opérationnalisation dans des plans de desserte et quant à leur mise en œuvre : Point positif cependant, il semble y avoir eu concertation entre les différentes entités du groupe. Deux remarques s’imposent en particulier.
— Proximité des échéances. Alors que les investissements ferroviaires se conçoivent, se planifient et se mettent en œuvre dans le temps long, l’entrée en vigueur du plan d’investissement élaboré est prévue pour l’année prochaine. Une fois de plus, des décisions en gageant l’avenir pour des décennies se prennent dans l’urgence, du moins au niveau de la décision politique. Cet engagement à long terme est non seulement le fait de la durée du plan et de l’importance des sommes engagées mais également celui des effets difficilement réversibles des options prises en matière de développement du réseau, de logique d’exploitation ou de standards techniques privilégiés. Autrement dit, les erreurs d’évaluation se paient cher et longtemps. Or, les instances politiques et la société civile se voient présenter une liste synthétique des projets déjà dans le pipeline du groupe SNCB depuis des années et correspondant à des options non délibérées en dehors du groupe sans que ne soient fournis les éléments permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la pertinence de la stratégie et sur la capacité des projets présentés à y répondre.
— Caractère bien trop secret et lacunaire de la préparation de la décision. En dépit de quelques formules vantant l’ouverture aux parties prenantes, le processus de décision ignore superbement les apports extérieurs au groupe SNCB. Dans ces conditions, intégrer le rail dans une politique globale de déplacements et d’aménagement du territoire relève de la gageure. Il est significatif qu’aucune mention ne soit faite dans le rapport d’une coordination avec les autres sociétés publiques de transport (De Lijn, STIB, SRWT), avec les partenaires sociaux ou avec les représentants des usagers. Cette orientation technocratique se traduit dans la forme par le rappel de quelques généralités sur l’évolution des comportements en matière de déplacements ainsi que sur l’implication des différentes « parties prenantes » suivies d’un catalogue de projets ventilés par poste budgétaire, correspondant peu ou prou aux entités du groupe gérant les différents aspects techniques d’un réseau de chemin de fer. Aucune mention n’est faite de l’orientation stratégique du groupe, notamment du rôle qu’il entend faire jouer au rail dans les enjeux sociétaux cités en introduction, ni du rôle que les projets proposés sont appelés à jouer au sein de cette stratégie.
Dans ces conditions, il n’est guère possible de juger de la pertinence de la stratégie du groupe ou du bien-fondé des projets repris puisque la première n’est pas explicitée et la contribution des seconds à la stratégie en question laissée dans le flou. En voulant ainsi éluder au maximum tout débat sérieux sur le rôle du rail dans la société, il est à craindre que le plan d’investissement ne donne lieu à une bataille de chiffonniers entre des politiques soucieux de défendre ce qu’ils perçoivent avec plus ou moins d’à propos comme « leur » projet au cours d’un marchandage ne laissant aucune place à une vision globale un tant soit peu cohérente. En tentant de préempter les réponses, le groupe SNCB ne favorise pas, c’est le moins qu’on puisse dire, que soient posées les bonnes questions. En clair, la SNCB demande d’avaliser les projets déjà dans le pipeline de ses services sans aucun débat d’orientation générale. Vu les sommes engagées et les performances du groupe durant les dernières années, tant sur le plan financier qu’en matière de qualité générale de services, c’est tout simplement inacceptable.
2.2. Des objectifs trop peu ambitieux et trop peu précis
Ce qui frappe à la lecture du plan est la quasi- absence d’engagements clairs de la part du groupe SNCB. La liste les investissements suggérés n’est aucunement connectée à la réalisation d’une stratégie que ce soit pour les voyageurs ou pour les marchandises. Pour peu qu’elle existe, il faut donc deviner entre les lignes tant la stratégie poursuivie que les modalités de son opérationnalisation. Il est en particulier consternant de constater combien, malgré l’importance des sommes engagées et l’importance des « attentes sociétales » énumérées en introduction du rapport, les investissements préconisés ne sont traduits dans aucun indicateur chiffré de production, de qualité et de productivité. Les seules indications données sont un objectif général d’augmentation de 2,2 % et de 2,8 % respectivement du nombre de voyageurs/km et de tonnes/km. Sur le plan de l’entretien du réseau, quelques indications sont données sur les objectifs de remplacements des différents composants de l’infrastructure en annexe.
Plusieurs remarques s’imposent.
Premièrement, les objectifs ne sont guère ambitieux malgré les apparences. Ils ne correspondent qu’à une très faible augmentation de la part modale du train dans l’ensemble des déplacements. Autrement dit, le plan présenté consiste à faire face à l’augmentation tendancielle du nombre de voyageurs en l’absence de politique volontariste visant à un transfert modal significatif. Il conviendrait au contraire de présenter aux décideurs et à la société civile différents scénarios, selon leur degré de volontarisme, en les mettant en lien avec d’autres choix collectifs à opérer en matière de mobilité et d’aménagement du territoire. Ces différents objectifs globaux de transfert modal espéré/souhaité devraient alors être ventilés en sous- objectifs en termes de quantités et de qualité des services rendus. On pense en particulier aux objectifs suivants.
— Augmentation du nombre de trains-km produits. L’habitude de comptabiliser les performances du groupe uniquement en termes de voyageurs/kms incite en effet à la poursuite de la politique historique du groupe SNCB de concentration de l’attention et des moyens quasi-exclusivement sur les trajets domicile/ travail longue distance perçus comme les plus rentables. L’indicateur conduit en effet à privilégier le seul degré d’occupation des trains en négligeant la valorisation des effets de réseaux de son offre |2|. Avec un tel indicateur, il paraît plus avantageux de mettre plus de monde dans les trains existants que d’en faire rouler davantage. Etant donné la part modale actuelle du rail et les réserves de capacité du réseau en dehors de la jonction Nord-Midi et de quelques autres points du réseau à l’heure de pointe, c’est pourtant bien des deux éléments dont nous avons besoin : plus de trains et plus de monde dans les trains |3|.
— Mesure et amélioration du temps global de déplacements (destination initiale/destination finale) et de fiabilité des services rendus aux usagers. La constitution d’un tel indicateur devrait être privilégiée plutôt que des objectifs de ponctualité des trains au regard de l’horaire théorique, par trop manipulable. Ceci devrait en particulier inciter le groupe SNCB à améliorer plus sérieusement la qualité et la fiabilité des correspondances. Cela devrait l’inciter également à considérer d’un meilleur œil les usagers du train utilisant par ailleurs des modes de transport doux ou communs, de même que son réseau de petites gares et points d’arrêts dès lors que ceux-ci permettent de diminuer les trajets d’approches et l’encombrement automobile autour des gares principales.
— Augmentation des fréquences et de l’amplitude de services. Il est largement établi en effet qu’il s’agit là d’un facteur essentiel d’attractivité du rail, y compris pour d’autres déplacements que le domicile-travail, là où il existe d’importantes réserves de capacités sur le réseau. Alors que le rapport énonce dans son introduction l’importance des autres motifs de déplacements que le domicile/travail |4| — domicile/école, aucune conséquence concrète n’est tirée de cette évolution dans la définition de l’offre et la planification des investissements. Un cadencement généralisé à la demi-heure, voire au quart d’heure sur les tronçons les plus denses, est un objectif souhaitable et, moyennant réorganisation du plan de transport et planification conséquente des investissements, réalisable à relativement brève échéance.
— Maillage du territoire. Il est sidérant de constater que rien n’apparaît concernant l’ouverture/réouverture de lignes et points d’arrêt là où il existe un potentiel d’usagers à proximité immédiate des lignes existantes ou susceptibles d’une remise en en service. Ceci se conçoit en lien avec une politique d’aménagement du territoire valorisant |5| de manière concertée des abords des gares et points d’arrêts, en particulier en zone urbaine.
— Amélioration de la productivité et de la densité d’utilisation du réseau |6|, notamment en comparaison avec les offres d’autres sociétés sur le plan international.
— Renouvellement des composants de l’infrastructure (voies, caténaires,…) et de la flotte de matériel roulant, modulés en fonction des objectifs précités.
Deuxièmement, du fait de leur caractère extrêmement vagues, les objectifs ne sont pas assez contraignants, ni dans le chef du groupe SNCB, ni dans le chef des pouvoirs publics. À défaut d’une perspective claire d’amélioration des performances du système ferroviaire prenant toute sa place au sein d’une politique plus globale de mobilité engageant toutes les parties, la confiance dans le rail tant des particuliers que des entreprises sera difficile à rétablir. Dans ces conditions, des choix notamment en matière d’aménagement urbain, de localisation de l’habitat et des entreprises ne viendront pas soutenir le transfert modal espéré. Le groupe SNCB doit proposer une perspective qui l’engage, pas des promesses vagues d’améliorations à venir, quitte à mettre ses partenaires face à leurs responsabilités lorsque la décision leur incombe.
2.3 Absence de traduction des objectifs assignés au rail en matière de transport de personnes dans un schéma d’exploitation à même de les rencontrer
Une fois de plus, le groupe semble analyser bien trop séparément l’évolution de l’infrastructure et son exploitation. À l’instar des exemples suisses ou néerlandais, il est pourtant plus que temps d’associer étroitement les investissements consentis dans l’infrastructure et le matériel roulant, d’une part et le type d’exploitation souhaitée, d’autre part. Il est de surcroît indispensable de planifier consciencieusement le développement progressif de l’infrastructure avec la mise en œuvre progressive du plan de desserte souhaité.
Il est tout simplement inadmissible qu’aucune mention ne soit faite ni du plan de transport futur pourtant en préparation au sein de SNCB Mobility, ni des perspectives à long terme. Plus grave, il est même écrit que le rapport a été élaboré suivant l’hypothèse « d’une trame générale de desserte globalement inchangée par rapport à la situation actuelle. » |7|. Or celle-ci, élaborée lors de la confection du plan IC/IR de 1984 et modifiée marginalement à quelques reprises depuis lors craque de toute part. Elle pose des problèmes croissants d’exploitation. Elle ne permet pas d’assurer des correspondances efficaces. Elle ne répond plus aux attentes des usagers d’aujourd’hui. En particulier, la SNCB semble une nouvelle fois louper le coche de la réorganisation de son réseau voyageur national autour de nœuds de correspondance performants |8| partout où c’est possible. Une telle logique permettrait de démultiplier les trajets pour lesquels le rail offre des solutions compétitives, tout en améliorant sensiblement la productivité du réseau et en diminuant les coûts d’exploitation par passager transporté. Pour cela, c’est autour d’un horaire théorique qu’il convient de décider des investissements et de leur planification. Par exemple, un relèvement de la vitesse sur un tronçon n’est pleinement justifié que s’il permet d’insérer une relation dans un nœud de correspondance afin de garantir des correspondances multiples tout en diminuant les temps de rotation du matériel et du personnel.
2.4. Quelques mots sur le transport de marchandises
Le projet d’investissement se situe dans la droite ligne de la voie historique suivie par la SNCB en matière de fret. Il concentre les moyens et l’attention sur l’activité portuaire et le développement de corridors frets autonomes par rapports aux axes voyageurs. Ceci se traduit notamment dans le plan d’investissement proposé par la réalisation de voies d’évitement pour les convois de plus de 750 mètres et la mise à double voie de la L 147 entre Fleurus et Auvelais. On peut cependant se demander en quoi la poursuite de cette politique historique produira des effets différents de ceux qu’elle a produits jusqu’à présent, à savoir une réduction importante, en tout cas en Wallonie, non seulement de la part modale du rail en matière de fret mais également du nombre absolus de tonnes/km transportées |9|. Dans ces conditions, pourquoi continuer à allouer des sommes importantes dans des projets d’infrastructure |10| qui n’ont pas rempli leurs promesses. Ils n’ont jusqu’à preuve du contraire pas permis de renverser la tendance à l’érosion du transport par rail de fret. Ils n’ont pas davantage permis de rétablir la rentabilité de la division logistique de la SNCB. À tout le moins, on est en droit d’attendre une remise à plat de la stratégie fret globale du rail en Belgique avant de poursuivre dans la voie engagée.
Il convient également, comme le souligne l’étude Tritel sur les priorités wallonnes en matière ferroviaire, que les autorités soient, enfin, cohérentes : « si la Wallonie décide de faire [l]e pari [du développement du fret ferroviaire], elle doit en toute cohérence l’accompagner d’une politique globale en faveur des alternatives à la route, afin de donner un maximum de chance de succès à cet investissement », en ce compris pour la desserte fine des entreprises situées en Wallonie, le transport combiné et le trafic diffus |11|. Si elle n’est pas disposée à le faire, il n’y a plus de raison de consacrer une part importante du budget d’investissement disponible à la réalisation de couloirs fret spécifiques destinés à être sous-utilisés et ne participant que marginalement à la compétitivité des entreprises wallonnes.
Il est donc indispensable de définir le rôle joué par le fret dans le développement économique de la Région et d’agir en conséquence sur l’ensemble des leviers disponibles. Ceci est en particulier important pour pérenniser les outils que constituent les gares de triage de Monceau et de Kinkempois ainsi que les raccordements industriels. En l’absence de stratégie industrielle en la matière, ceux-ci sont menacés comme l’a montré le sort du triage de Ronet, abandonné par la division logistique de la SNCB en dépit d’une rénovation menée quelques années auparavant.
2.5 Développement du réseau ferroviaire et logique territoriale
Le plan d’investissement proposé passe largement à côté du rôle structurant du rail sur l’organisation d’un territoire et sur les responsabilités qui en découlent pour ceux qui en ont la charge. De manière à peine caricaturale, la SNCB semble appréhender ce rôle uniquement à travers la fourniture aux navetteurs des places de parkings payants et des services commerciaux dans les principales gares du pays. Rien n’est dit ni prévu par contre en ce qui concerne la valorisation des abords des gares et points d’arrêts en vue d’une densification qualitative de l’occupation du territoire. Plutôt que de courir exclusivement derrière les navetteurs autosolistes, le réseau ferré devrait être davantage placé au service des centres urbains et de la qualité de vie de ses habitants. Là encore, l’étude Tritel formulait la philosophie générale qu’il convient d’adopter. Ainsi dans ses conclusions générales : « c’est globalement la place des gares dans le tissu bâti qui doit être reconsidérée avec soin. La croissance attendue de la population va générer de nouveaux besoins qui devraient être localisés autour des gares pour multiplier les chances d’un report modal de la voiture vers le train ». De ce point de vue, le plan d’investissement dans sa mouture actuelle est une occasion manquée.
Il ne développe aucune perspective d’utilisation des infrastructures existantes pour développer des réseaux urbains et suburbains autour d’Anvers, Liège, Charleroi et Gand |12|. La SNCB semble refuser purement et simplement le potentiel largement sous-exploité du réseau ferré belge pour ce type de déplacements, en dépit de nombreux exemples de succès dans d’autres pays européens. Une telle orientation nécessiterait naturellement une intégration effective, tant sur le plan de la définition de l’offre que sur le plan tarifaire, avec les transports urbains de chacune de ces villes. Ces projets nécessitent certes des moyens mais ceux-ci restent raisonnables au regard d’autres investissements de « prestige » consentis par la SNCB mais également eu égard aux bénéfices que l’on peut en attendre tant sur le plan économique que social. Accessoirement, c’est aussi la meilleure manière de drainer des usagers vers les grandes lignes du trafic intérieur et international.
Le plan d’investissement ne fournit aucune perspective de réouverture de lignes et aucune stratégie lisible de réouverture de points d’arrêts sur les lignes existantes |13|. Plus exactement, elle soumet tout nouveau projet en dehors de la liste qu’elle établit à des financements extérieurs à la dotation d’investissement, en pointant notamment du doigt les Régions. Dans son ébauche, la SNCB ignore une nouvelle fois d’envisager la réouverture au service voyageur |14| de lignes dont il est pourtant possible d’affirmer qu’elles n’auraient jamais dû être fermées et constituent autant de maillons manquants dans un réseau théorique de transports en commun. Devraient être à tout le moins sérieusement envisagées la réouverture au trafic voyageurs les lignes 141 Nivelles - Ottignies, 125 A Liège - Seraing - Flémalle, 97, Quiévrain - Valenciennes ou 163 Libramont - Bastogne, de même que les lignes 52 et 57, (Anvers) – Puurs – Termonde - Alost, 29 Aarschot - Herentals – (Turnhout), 21 A (Hasselt) - Genk - Maasmechelen ou 18 Hasselt - Neerpelt. A quel prix le pétrole devra-t-il monter pour que l’on envisage de revenir sur des décisions basées sur une philosophie datant parfois d’avant le premier choc pétrolier et sur des chiffres de population et des modes de déplacements complètement dépassés ?
Le plan d’investissement ne comporte pas davantage d’engagement précis relatif à la rénovation, l’entretien et la valorisation des points d’arrêts non gardés et des petites gares, pourtant largement négligés depuis des décennies. Cela coûte pourtant a priori nettement moins cher que les projets de grande gare tout en diffusant mieux les flux de voyageurs et en soutenant une stratégie de croissance plus équilibrée. C’est au contraire à la poursuite de la concentration des moyens dans les grandes gares et leurs parkings que l’on assiste. Aucun engagement n’est pris en faveur de la facilitation des modes doux comme en matière d’accessibilité des infrastructures aux personnes à mobilité réduite. Cet aspect est pourtant essentiel non seulement pour les personnes souffrant d’un handicap mais également pour une part importante de la population dans certaines circonstances de la vie : femmes enceintes, personnes âgées, voyageurs chargés de bagage,… De même, l’intégration tarifaire avec les autres sociétés de transport n’est aucunement envisagée. Lorsqu’il est question de chaîne logistique, c’est bien à l’amélioration de l’expérience quotidienne des usagers qu’il faut d’abord penser plutôt qu’au développement de gadgets liés aux nouvelles technologies.
2.6. Le cas de la jonction nord-midi
Ce point mériterait de plus amples développements. Quelques remarques cependant.
La saturation de la jonction ne doit pas être une excuse « technique » pour ne pas développer l’offre par ailleurs, en particulier sur l’ensemble des relations ne passant pas par Bruxelles où d’importantes réserves de capacités existent. Le train dispose d’atouts sur d’autres types de trajets que vers le centre de Bruxelles, à condition de développer une offre adaptée. De ce point de vue, la SNCB paie aujourd’hui les conséquences de ces orientations passées par trop concentrées sur le trafic de navetteurs vers Bruxelles et la désaffection progressive de nombreux itinéraires alternatifs ne transitant pas par la jonction Nord-Midi.
Il est frappant de constater que trois solutions partielles à l’engorgement de la jonction ne sont purement et simplement pas envisagées dans le rapport. Celui-ci se contente de faire état des flux actuels durant la pointe matinale et des limites théoriques de capacité de la jonction. Chacun de ces éléments de solution nécessite il est vrai de reconfigurer le plan de dessertes et à plus long terme la structure du réseau ferré dans et autour de la capitale. C’est pourquoi ils devraient donc être pris en compte lors de la recherche d’une solution globale à l’occasion de la mise en œuvre du RER autour de Bruxelles. Là encore, les investissements portant sur l’infrastructure et le matériel roulant devraient être conditionnés par les options arrêtées en matière d’exploitation, et non l’inverse.
— L’utilisation performante de la ligne 28 traversant l’ouest de l’agglomération bruxelloise n’est purement et simplement pas envisagée. Elle forme pourtant une ceinture ouest dans l’agglomération bruxelloise bien connectée au réseau de métro. Celle-ci pourrait être utilisée pour certains axes RER venant de l’ouest et du nord de l’agglomération bruxelloise et former ainsi une ou plusieurs tangentielles intéressantes à la fois pour Bruxelles et le Brabant flamand.à l’instar de la ligne 26 Halle-Vilvoorde faisant de même à l’est de la jonction Nord-Midi. L’utilisation de cette dernière est elle aussi laissée dans le flou le plus complet.
— De manière générale, l’exploitation du RER devrait s’organiser de manière telle à permettre des correspondances avec le réseau de transports urbains d’une part et le réseau IC/ IR d’autre part dans une ou plusieurs gares situées en amont de la jonction nord-midi (Jette, Schaerbeek, Etterbeek, Uccle Calvoet,…). Ceci permettrait de désengorger la jonction mais également la section centrale du métro (ligne 1-5), tout en offrant des liaisons plus performantes pour des pans entiers de la capitale. De ce point de vue, l’absence de concertation avec la STIB et les autorités bruxelloises est catastrophique. On risque d’engloutir des milliards dans l’élargissement de la jonction nord-midi pour amener des voyageurs au centre de Bruxelles qu’il faudra ensuite dispatcher aux quatre coins de la capitale, ce qui nécessitera en retour le percement de lignes de métro.
— À terme, il faudrait envisager le bouclage d’une grande ceinture ferroviaire en amont de l’agglomération bruxelloise permettant d’une part de diminuer le nombre de correspondances dans les gares bruxelloises et d’autre part d’améliorer sensiblement les temps de parcours et l’attractivité du rail sur des relations internes tant à la Flandre qu’à la Wallonie. (cfr. projet transbrabançonne et équivalents en Flandre)
Quelques mots de conclusion
Les choix d’investissements doivent préserver l’essentiel à savoir le maintien en l’état du réseau existant et la conservation ou la restauration de ses performances. Mais cela ne suffit pas à établir une stratégie globale de reconquête de la confiance des usagers et des partenaires économiques et sociaux qui soit en mesure de préparer l’avenir. C’est maintenant que cela se décide.
|1| 944 décès ont ainsi été recensés en 2009 sur les routes belges en 2009 ainsi que 6640 blessés graves. Chiffres tirés de l’observatoire de la sécurité routière de IBSR. Ce chiffre ne tient compte que des accidents de la route et non des morts prématurées engendrées par la pollution émise par la circulation automobile.
|2| Elle renforce la focalisation exclusive de l’offre et des moyens sur les tronçons déjà saturés ou en passe de l’être plutôt que sur la valorisation des réserves de capacités du réseau là où elles sont importantes.
|3| Du moins ceux dont le taux d’occupation ou la composition laisse d’importantes marges de croissance.
|4| Qui répondent par ailleurs à des schémas horaires et spatiaux de plus en plus irréguliers.
|5| Au sens de l’utilisation rationnelle du territoire, pas au sens de la spéculation immobilière…
|6| Contrairement à ce que le groupe SNCB laisse souvent entendre en se focalisant exclusivement sur le problème de la jonction nord-midi, le réseau belge est loin d’être le plus densément utilisée.
|7| Plan d’investissement, p.22.
|8| Présentation du concept étude Tritel ; W. Oldenziel (Spoor 2020 Treintrambus).
|9| Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Le nombre de tonnes/km transportées est passé de 4300 à 2400 millions entre 1990 et 2009 et la part modale du rail de 26, 6 à 10,2 %. Source IWEPS
|10| On peut penser, en particulier, à l’électrification de l’Athus-Meuse et de la ligne 24 via Montzen.
|11| Etude Tritel, p. 101.
|12| Cf. article 10 du contrat de gestion qui imposait d’étudier la question
|13| Même si le simple fait qu’une ligne budgétaire symbolique soit assignée à cet effet puisse être lu comme un signal d’encouragement vu la frilosité historique de la SNCB en la manière. De même pour le fait que l’achat à terme de matériel léger soit à terme envisagé.
|14| Avec une exception pour la prolongation du service voyageur en provenance d’Anvers de Neerpelt à Hamont sur la ligne 19.
À propos de l'auteur
Cette publication a reçu le soutien
du ministère de la culture,
secteur de l'Education permanente

Les commentaires des internautes
1 message
Votre analyse a oublié de prendre en considération le développement d’un trafic ferroviaire fret grande vitesse devant relier demain les grandes Métropoles Européennes ainsi que le préconisent le Livre Blanc et le programme RTE-T de la Commission et du Parlement Européen !
La Belgique et la Wallonie peuvent elles se passer d’être desservies par ce réseau ferroviaire fret trans-européen de demain ..sans prévoir des a présent dans sa programmation les investissements nécessaires ?